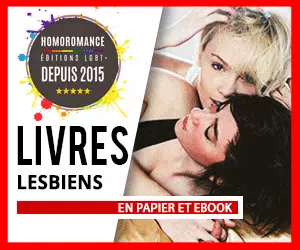Une perspective internationale de la psychologie lesbienne

Des chercheurs des Philippines, du Mexique, de l'Italie, de l'Allemagne, du Chili, du Canada, du Brésil, de la Chine et des États-Unis apportent un éclairage nouveau sur des questions essentielles en psychologie lesbienne tout en remettant en question la domination des recherches occidentales. Cet article s’éloigne d’une vision monolithique de l’identité LGBTQ+ pour se concentrer sur l’identité lesbienne. Une diversité de contributions explore des questions centrales en psychologie, notamment les différences entre la santé mentale des hommes gays et des femmes lesbiennes, ainsi que les similitudes et divergences entre l’identité des femmes lesbiennes et bisexuelles. Cet article pousse le domaine à considérer comment des valeurs culturelles comme le collectivisme et l’individualisme, l’affiliation religieuse et les intersections entre misogynie et homophobie influencent le risque de problèmes de santé mentale, la violence conjugale et l’insatisfaction corporelle chez les femmes lesbiennes.
Sommaire
- Introduction
- Différences entre les femmes et les hommes appartenant à des minorités sexuelles
- Différences entre lesbiennes et femmes bisexuelles
- L’importance des valeurs culturelles dans l’étude de la psychologie lesbienne à l’échelle mondiale
- Facteurs de stress supplémentaires pour la santé mentale des lesbiennes et des femmes issues de minorités sexuelles
- Réflexions finales
Introduction
Les contributions de cet article élargissent notre compréhension de la psychologie lesbienne à travers une perspective internationale. L’approche comparative permet d’examiner comment la psychologie lesbienne varie selon les pays, en fonction du niveau d’acceptation des minorités sexuelles. Elle offre également une meilleure compréhension des effets des valeurs culturelles et des croyances religieuses sur l’identité lesbienne, ainsi que des obstacles structurels (tels que l’accès aux soins de santé ou la citoyenneté) pouvant expliquer les différences en matière de santé mentale chez les lesbiennes.
Cet article s’attache à mettre en avant l’identité lesbienne et à éviter une approche homogénéisante. Parfois, il est pertinent d’inclure des échantillons LGBTQ+ lorsque les enjeux sont similaires, mais il existe des différences fondamentales dans la manière dont les lesbiennes et les femmes bisexuelles prennent conscience de leur identité sexuelle, établissent des relations amoureuses, vivent la stigmatisation et forment des communautés, comparé aux hommes gays et bisexuels. Par exemple, certaines études révèlent des différences significatives entre les femmes lesbiennes/bisexuelles et les hommes gays/bisexuels en ce qui concerne l’importance accordée aux liens émotionnels par rapport aux liens sexuels. Ces différences ont un impact sur l’expérience des lesbiennes pendant la pandémie de COVID-19. Elles influencent également la manière dont l’homonégativité intériorisée façonne les relations lesbiennes différemment de celles des hommes gays. D’autres contributions explorent les similitudes et différences entre lesbiennes et femmes bisexuelles. Par exemple, certains chercheurs suggèrent que les femmes bisexuelles rencontrent davantage de problèmes de santé mentale que les lesbiennes en raison d’un accès plus limité aux soins psychologiques et d’un moindre niveau d’acceptation sociale dans certains pays. Cependant, une autre étude menée en Allemagne n’a pas constaté de telles différences, ce qui pourrait être lié à un niveau d’acceptation plus élevé.
Ce numéro spécial met aussi en lumière le rôle ambivalent des valeurs culturelles comme le collectivisme, qui peut être à la fois un facteur de protection et un facteur de risque. Par exemple, des valeurs collectivistes fortes peuvent favoriser la formation d’une communauté lesbienne solide, mais elles peuvent aussi imposer des obligations familiales restrictives, comme l’attente d’être une fille soumise. Enfin, ce numéro montre que, quel que soit le contexte géographique, le sexisme et la misogynie influencent la vie des lesbiennes, que ce soit à travers l’expérience de l’immigration, la perception du corps ou la carrière des chercheuses spécialisées en psychologie lesbienne.
Article en rapport : Suis-je lesbienne ? Comment savoir si j'aime les femmes ?
Différences entre les femmes et les hommes appartenant à des minorités sexuelles
Une étude portant sur les comportements sexuels et la santé mentale des minorités sexuelles au Mexique montre que les femmes utilisaient plus fréquemment les applications de rencontre pendant la pandémie. Toutefois, contrairement aux hommes gays, cette augmentation de l’utilisation des applications ne s’est pas traduite par une hausse du nombre de partenaires sexuels. De plus, les femmes appartenant à une minorité sexuelle étaient moins susceptibles d’avoir recours à la drogue lors de rapports sexuels comparé aux hommes gays. En revanche, elles ont signalé des niveaux de stress, d’anxiété, de dépression et d’idéation suicidaire nettement plus élevés que les hommes gays pendant la pandémie. Ces différences suggèrent que l’isolement accru lié à la crise sanitaire a eu un impact plus marqué sur la santé mentale des femmes que sur celle des hommes.
Une autre étude menée en Amérique latine explore les différences entre lesbiennes et hommes gays en matière d’homonégativité intériorisée et de son impact sur les relations amoureuses. Chez les couples lesbiens chiliens, lorsque l’une des partenaires intériorise l’homonégativité, l’autre est moins susceptible de ressentir de la satisfaction sexuelle, un phénomène qui ne se retrouve pas chez les couples gays. Cette distinction pourrait s’expliquer par la tendance des lesbiennes à privilégier des relations où l’attachement émotionnel est central. En raison de cette proximité émotionnelle, les lesbiennes peuvent être plus sensibles aux effets de l’homophobie intériorisée de leur partenaire, ce qui peut affecter leur satisfaction sexuelle.
Différences entre lesbiennes et femmes bisexuelles
De nombreuses études, principalement menées aux États-Unis, indiquent que les femmes bisexuelles souffrent davantage de troubles de santé mentale que les lesbiennes. Une contribution italienne apporte des explications supplémentaires sur ces différences. Elle montre que les lesbiennes en Italie rapportent un niveau plus faible de stigmatisation sexuelle intériorisée et une meilleure conscience de leur identité que les femmes bisexuelles. Pour certaines d’entre elles, l’incertitude liée à leur orientation sexuelle peut engendrer un sentiment d’insécurité et de mal-être. Ce phénomène pourrait expliquer pourquoi certaines femmes bisexuelles, qui doutent encore de leur identité, présentent un risque accru de troubles psychologiques.
Cependant, une comparaison avec des recherches menées en Allemagne montre que ces écarts ne sont pas universels. Une étude comparant la santé mentale des lesbiennes et des bisexuelles en Allemagne révèle que ces deux groupes présentent des taux de troubles psychologiques plus élevés que les femmes hétérosexuelles. Toutefois, contrairement aux résultats obtenus dans d’autres pays, aucune différence significative n’a été observée entre lesbiennes et bisexuelles. Selon cette étude, les écarts relevés dans d’autres pays pourraient être liés à des différences structurelles, notamment un accès plus aisé aux soins de santé mentale et un niveau de stigmatisation plus faible à l’égard des personnes LGBTQ+ en Allemagne.
L’importance des valeurs culturelles dans l’étude de la psychologie lesbienne à l’échelle mondiale
Une étude menée aux Philippines indique que les femmes, qu’elles soient hétérosexuelles ou issues d’une minorité sexuelle, sont confrontées quotidiennement à des discriminations en raison de leur genre, comme un traitement hostile dans les magasins et restaurants. Pour les femmes issues de minorités sexuelles, ces expériences augmentent le risque de souffrir de dépression et d’anxiété. Cette situation pourrait être aggravée par l’absence de soutien de la part d’un réseau de pairs soudé, un élément pourtant central dans la culture philippine.
En Chine, une étude met en lumière des niveaux élevés de violence conjugale chez les lesbiennes, un phénomène également répandu en Occident. L’hétérosexisme y joue un rôle déterminant, notamment à travers les attentes familiales imposées aux femmes lesbiennes. Beaucoup sont poussées à rester dans le placard ou à contracter des mariages arrangés avec des hommes gays pour préserver l’harmonie familiale. De plus, l’absence de reconnaissance légale des couples lesbiens en Chine contraint celles qui subissent des violences à se tourner vers des organisations LGBTQ+ et féministes pour trouver du soutien. Si de nombreuses études de ce numéro reposent sur la théorie du stress minoritaire, il apparaît essentiel de repenser cette approche en tenant compte des normes culturelles, qui peuvent à la fois protéger et fragiliser les lesbiennes dans différentes sociétés.
Facteurs de stress supplémentaires pour la santé mentale des lesbiennes et des femmes issues de minorités sexuelles
D’autres contributions examinent en profondeur les expériences des femmes lesbiennes et bisexuelles en lien avec la santé mentale, notamment la dépression et l’anxiété. Une étude menée au Brésil montre que des facteurs psychologiques tels que le perfectionnisme et une faible estime de soi contribuent à une insatisfaction corporelle élevée, tant chez les femmes hétérosexuelles que chez celles issues de minorités sexuelles. Un facteur de stress supplémentaire pour ces dernières réside dans la nécessité de dissimuler leur orientation sexuelle et l’intériorisation des attitudes homophobes. Cette découverte pourrait aider les professionnels de la santé mentale à mieux traiter des troubles comme l’anorexie et la boulimie, en élargissant leur approche au-delà de l’estime de soi pour inclure la manière dont ces femmes perçoivent leur identité sexuelle.
Une autre contribution introduit le concept de migrations multiples. De nombreuses lesbiennes forment des réseaux transnationaux où elles peuvent vivre librement et célébrer leur identité. Dans ces espaces, elles tissent des liens d’amitié et des relations amoureuses. Toutefois, l’absence de reconnaissance légale des couples lesbiens complique l’immigration pour celles qui souhaitent rejoindre leur partenaire. Une étude portant sur un couple lesbien ayant immigré à travers plusieurs pays révèle une intersection entre sexisme et homophobie qui complique leur quotidien. Ces femmes se heurtent à des obstacles structurels pour l’obtention d’un visa permanent, à un manque d’opportunités professionnelles et à des microagressions sur leur lieu de travail en raison de leur non-conformité de genre. De plus, l’éloignement de leur famille d’origine entraîne une perte de lien et un isolement social. Cette analyse approfondie met en évidence les oppressions imbriquées qui façonnent la vie des femmes queer.
Réflexions finales
Ce numéro spécial se clôt sur une interview de la rédactrice en chef sortante du Journal of Lesbian Studies, qui revient sur plusieurs thématiques abordées, notamment les similitudes entre lesbiennes et bisexuelles (une forte proportion de ces femmes étant diplômées, anticonformistes et éloignées de leur famille). Elle insiste également sur la nécessité de prendre en compte la misogynie dans la recherche sur la psychologie lesbienne. Contrairement aux hommes gays, les lesbiennes subissent une oppression non seulement en raison du stress minoritaire lié à leur orientation sexuelle, mais aussi parce qu’elles appartiennent à un groupe perçu comme menaçant pour l’ordre établi : les femmes. Ces oppressions – sexisme, misogynie et lesbophobie – s’entrelacent avec des différences culturelles et des obstacles structurels, créant ainsi une expérience lesbienne unique selon les contextes géographiques.
À une époque où peu d’études en psychologie se concentrent sur les lesbiennes, vous trouverez via le lien ci-dessous des découvertes essentielles et approfondit de notre compréhension de l’identité lesbienne à travers différentes cultures. En explorant l’impact des valeurs culturelles sur la vie des lesbiennes et bisexuelles, ainsi que les interactions entre misogynie et homophobie, il contribue à faire progresser ce champ de recherche. L’objectif est d’encourager de futures études à identifier les spécificités culturelles et à mettre en lumière non seulement les défis auxquels sont confrontées les lesbiennes dans le monde, mais aussi les moyens par lesquels leurs communautés œuvrent à leur émancipation et à leur bien-être.
Source : tandfonline.com
— Contribuez à notre magazine participatif —
Vous souhaitez écrire un ou plusieurs articles pour notre site ? Le Lesbia Magazine est un média libre et indépendant souhaitant porter toutes les voix de la diversité au féminin.
Envoyez-nous dès à présent votre sujet d'article via notre page de contact, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.