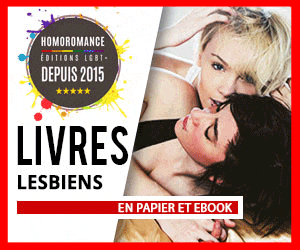Sélection du Prix Gouincourt : inclusion ou exclusion dans la littérature lesbienne ?

En mars dernier, l'équipe vous présentait la création du Prix Gouincourt, un prix littéraire pensé pour mettre à l’honneur la littérature lesbienne, car il faut le dire, elle reste depuis longtemps absente du paysage des grandes distinctions françaises. Dès lors, le Gouincourt, avec son nom impertinent, son jury queer et militant, et son ambition de donner une visibilité réelle aux romans centrés sur des thématiques lesbiennes, semblait être le plus beau projet lesbien national de ce début d'année... Il faut le dire, le projet avait tout pour séduire toute la communauté lesbienne et combler un manque évident pour noues mettre en avant.
Quelques mois plus tard et à l’heure de l'annonce des premières sélections, mon enthousiasme se teinte pourtant d’interrogations. Car si le prix se voulait inclusif, son positionnement actuel soulève une question délicate : peut-on défendre l’inclusion en choisissant d’exclure certaines voix de notre communauté déjà mal représentée dans toutes les sphères médiatiques ?
Sommaire
Un prix littéraire n'est jamais neutre
Si, comme moi, vous pensiez qu’un prix littéraire pouvait être neutre, il est temps de vous réveiller.
Un prix n’est jamais une simple récompense : c’est un geste politique. Il affirme une vision du monde et choisit ce qui mérite d’être mis en avant et le Prix Gouincourt ne s’en cache pas : il veut afficher ses valeurs et prendre position.
Les critères de sélection prévoyaient de ne considérer que les romans lesbiens de littérature générale francophones sortis entre la mi-août et la mi-octobre. L’idée était simple : inscrire la littérature lesbienne dans le moment médiatique de la rentrée littéraire, au cœur d’une période où les projecteurs se tournent vers les écrivains stars et les révélations de l’année.
Le résultat de cette première sélection n’a pas semblé convenir aux organisateur·ices :
Au départ, nos critères de sélection prévoyaient de ne considérer que les romans lesbiens de littérature générale francophones sortis entre la mi-août et la mi-octobre. Face à la première liste établie sur ces critères factuels, le constat était implacable : elle était composée d’une grande majorité d’autrices blanches, cis, valides.
C'est là que nous entrons dans le cœur du problème. Ici les organisatrices ne remettent pas en cause les textes, mais l’identité de celles qui les ont écrits. Autrement dit, ce n’est pas la qualité des œuvres qui devient déterminante, mais la représentativité de leurs autrices.
Peut-on penser que le prix qui devait mettre en avant la littérature lesbienne, a glissé vers une logique de quotas ?
Des cases plutôt que des pages
Si on comprend bien le message initial : les textes remplissaient les conditions, mais l’identité de celles qui les avaient écrits posait problème. Ce n’était donc pas la qualité des œuvres qui était en cause, mais bien la composition sociologique de leurs autrices.
À partir de là, deux questions dérangeantes surgissent :
- A quel moment passe-t-on d’une démarche de reconnaissance nécessaire à une logique de hiérarchisation identitaire ?
- Quand la valeur d’un roman est-elle reléguée au second plan, derrière la couleur de peau, le genre ou la validité de son autrice ?
Et d'ailleurs, y'a-t-il une hiérarchisation de la validité ? Faut-il un rapport de médecin ou une attestation de handicap ? Si on a l'air blanc et que notre extrait d'acte de naissance prouve qu'on est un enfant de parent immigré racisé, cela compte-t-il ? Je parle aussi en connaissance de cause : je ne corresponds pas non plus aux cases simplistes qu’on voudrait cocher pour moi. Mais faut-il vraiment exhiber des certificats ou des papiers d’identité pour prouver qu’on a sa place ? En sommes-nous vraiment arrivés à ce point ?
Le paradoxe est là : un prix né pour donner de la visibilité à une littérature invisibilisée en vient à invisibiliser, à son tour, une partie des lesbiennes et il me semble pertinent de penser que la littérature n’a pas besoin d’un certificat d’identité pour exister. Ce qui doit primer, ce sont les pages, pas les papiers d'identité.
Il faut aussi rappeler qu’un roman n’est pas une simple production industrielle. Certaines autrices mettent des années à écrire un seul livre, parfois l’unique livre de leur vie. Ce sont leurs tripes, leur âme, jetés sur le papier, une part d’elles-mêmes offerte au monde. Méritent-elles, parce qu’elles n’entrent pas dans les bonnes cases identitaires, d’être bannies d’un concours ? Est-ce juste ? Et surtout, les nominées elles-mêmes valident-elles vraiment cette logique de compétition ?
L’inclusion sélective, un nouveau paradoxe
L’intention est évidemment importante : lutter contre les discriminations doit rester une priorité dans nos communautés, et les organisateurs du prix Gouincourt rappellent que cette composante "blanche, cis, valide"...
... ne nous satisfaisait pas. Était-ce cette image que nous souhaitions renvoyer pour la première édition du Prix Gouincourt ? Dans une période où le racisme, la transphobie, le validisme et globalement la montée de l’extrême droite sont palpables partout, y compris dans le monde de l’édition, nous voulons affirmer les valeurs que nous défendons.
Notre prix doit refléter notre engagement contre toutes les formes de discrimination, même quand elles sont ancrées dans les habitudes du milieu de l’édition. Ces préoccupations sont les nôtres, et nous savons la portée politique d’un prix littéraire.
Et précisément, le paradoxe est là : un prix né pour donner de la visibilité à une littérature invisibilisée en vient à invisibiliser à son tour une partie des lesbiennes. Sous prétexte de combattre certaines dominations, on finit par créer de nouvelles hiérarchies, qui rejettent des autrices sur le simple critère de leur identité.
La lutte contre les discriminations mérite mieux que de reproduire, ou même d'inverser, la logique qu’elle souhaite abolir.
Sélectionner un texte ou une identité ?
En tant qu’éditrice, j’ai toujours considéré qu’un texte parle plus qu'une pièce d'identité ou encore le CV d'un auteur. Chez Homoromance Éditions, les manuscrits proposés passent par un comité de lecture de façon anonyme. Personne ne sait qui se cache derrière les pages, et cela ne nous a jamais empêchés de publier des auteur·ices trans ou racisé·es, simplement parce que ce qui est important : c'est leur voix.
Quand nous transmettons les comptes rendus du comité de lecture à un auteur, nous n’écrivons jamais : "votre manuscrit a été retenu parce que vous appartenez à une catégorie discriminée de la population." Nous parlons de ce qui importe vraiment : la puissance de son récit, son originalité, et les pistes pour l’affiner.
À titre personnel, je trouverais franchement humiliant que l’on retienne mon texte pour mes origines marocaines, mon autisme ou ma non-binarité plutôt que pour sa valeur littéraire.
Depuis quand la littérature a-t-elle besoin de connaître les origines, les croyances, la sexualité ou le genre d'un auteur pour exister, elle s’impose par le talent de l'auteur ou de l'autrice, sa voix, son style, son souffle.
Nous avons publié des auteur·ices sans diplômes, sans réseau littéraire, sans formation universitaire... Certain·es viennent de métiers éloignés du livre, infirmière, enseignante, employée de caisse, etc... - et pourtant leurs histoires et leur plume ont cette force qui s’impose d’elle-même et qui ne se discute pas. Et ces autrices ou auteurs trouvent une place grâce à la qualité de leur récit, pas grâce à un parcours estampillé légitime parce qu'issus de tel ou tel parcours identitaire ou universitaire.
C’est cela, au fond, la justice littéraire : donner sa chance à une œuvre, peu importe la personne qui la signe.
La littérature mérite mieux que des quotas. Le risque, en voulant trop corriger les déséquilibres, c’est d’installer de nouvelles exclusions, parfois au cœur même des communautés que l’on prétend défendre.
Il existe une voie juste : juger les œuvres de manière anonyme, sans délit de faciès, sans que l’identité de l’autrice ou de l’auteur ne vienne fausser la lecture. Ce système est déjà utilisé dans de nombreux comités éditoriaux (comme le nôtre) ou au sein d'autres concours, ce qui permet d’offrir à toutes les voix une réelle égalité de départ.
Car au fond, la littérature se tient dans les mots, dans la force d’un récit, dans la singularité d’une écriture. Tout le reste devrait rester hors champ.
Nous félicitons bien sûr les heureuses nominées !
- Nour Bekkar, Corps étranger sous la peau (Blast)
- Sabrina Calvo, Mais cette vie-là demande. toujours. plus. de. lumière. (Éditions du commun)
- Camille Corcéjoli, Transatlantique (La Contre Allée)
- Fatima Daas, Jouer le jeu (L’Olivier)
- Wendy Delorme, Le Parlement de l’eau (Cambourakis)
- Juliet Drouar, Cui-cui (Seuil)
- Pauline Gonthier, Parthenia (Les Léonides)
- Gorge, Fatalee ou l’impossible phantasme* (Trou Noir)
- Lucie Heder, La grande verdure (La Volte)
- Lumen, L’endroit de mon trouble (La Musardine)
- Céline Minard, Tovaangar (Rivages)
- Anne-Fleur Multon, À croquer (Thierry Magnier)
- Nelly Slim, Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs)
- Laura Vazquez, Les Forces (Éditions du sous-sol)
J'aimerai finir par ceci : je suis heureuse d’avoir fondé une maison d’édition lesbo-féministe et universaliste qui défend une conviction simple : juger un texte pour ce qu’il est, non pour l’identité de celle ou celui qui l’écrit.
Parce qu’au fond, le talent, toujours, doit passer avant les cases.
Quoi qu'il en soit, nous ne manquerons pas de suivre les résultats et de partager avec vous le nom de la ou des lauréates à qui nous souhaitons de gagner en visibilité grâce à cette opportunité.
Ci-dessous, le post complet de l'organisme
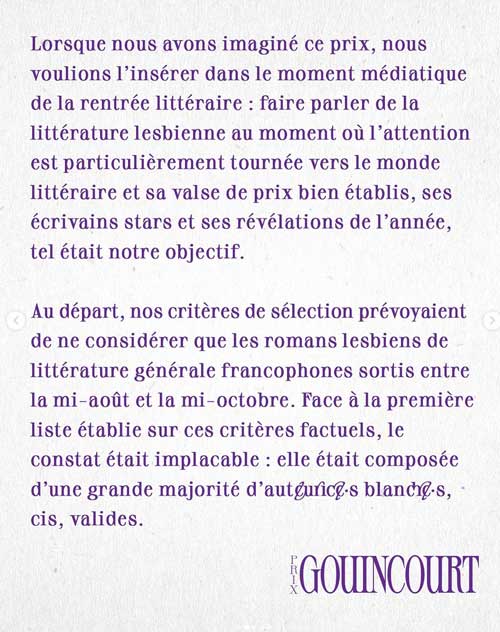
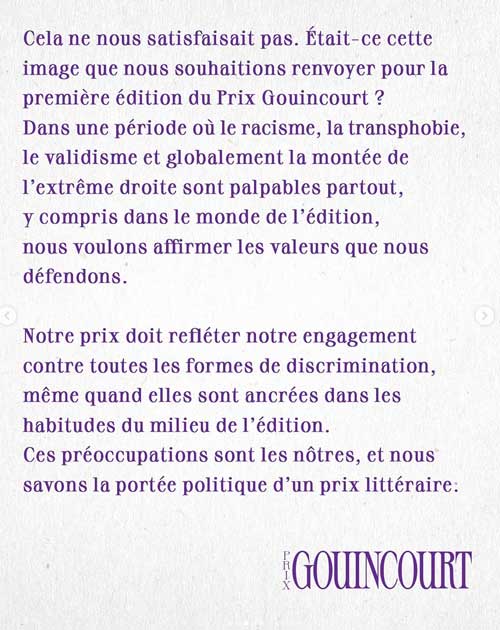
— Contribuez à notre magazine participatif —
Vous souhaitez écrire un ou plusieurs articles pour notre site ? Le Lesbia Magazine est un média libre et indépendant souhaitant porter toutes les voix de la diversité au féminin.
Envoyez-nous dès à présent votre sujet d'article via notre page de contact, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.