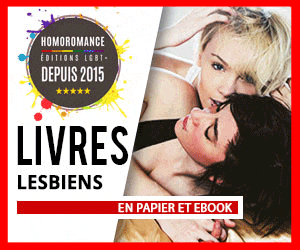Qu’est-ce que cela signifie d’être une lesbienne butch ou mascu en 2026 ?

Quand j’étais une jeune adulte encore dans le placard, je portais parfois des robes. Pas des tenues ultra-féminines façon robe victorienne, mais des robes tout de même, dans le but de détourner les soupçons sur mon homosexualité. Et étonnamment, ça fonctionnait. Malgré mon corps massif et butch, beaucoup de gens partaient du principe que j’étais hétérosexuelle. À l’époque, c’était exactement ce dont j’avais besoin. Aujourd’hui encore, la distinction entre la mode masculine et féminine reste ancrée dans notre culture. Toute déviation par rapport à cette norme peut entraîner des conséquences allant du harcèlement léger à une hostilité manifeste.
Bien avant Stonewall en 1969, la culture butch/femme était déjà très présente dans les bars clandestins aux États-Unis, calquant d’une certaine manière les rôles de genre hétérosexuels.
Traditionnellement, une lesbienne butch est définie comme une femme dont l’expression de genre (apparence, vêtements et comportement) est plus masculine, tout en s’identifiant toujours comme femme. Mais cette définition est bien trop simpliste. L’identité butch est souvent plus fluide qu’il n’y paraît.
J’ai connu de nombreuses lesbiennes qui se considéraient comme femmes, qui portaient des robes mais qui, dans leur comportement, étaient bien plus butch que je ne le serai jamais. Pourtant, il existe encore des gardiens du temple persuadés que l’identité butch se définit uniquement par une apparence et un comportement uniformes. Mais jusqu’à quel point notre apparence extérieure dicte-t-elle notre identité de genre en tant que butch, femme, non-binaire, etc. ?
Dans le film Victor Victoria, une partie de l’humour repose sur une femme qui se fait passer pour un homme se faisant passer pour une femme. En tant que lesbienne butch, je m’habille comme un homme, mais j’ai été poussée à m’habiller comme une femme, pour au final revenir à une tenue masculine. Alors vous pourriez vous demander, en voyant ces images où je porte une robe victorienne des années 1880 : Pourquoi ? Pourquoi moi, une femme qui s’affirme masc, ai-je choisi non seulement d’enfiler cette robe, mais aussi de poser avec ? Avais-je perdu un pari ? Je suis clairement passée au-delà du point où l’on peut me forcer à porter des vêtements féminins.
Mais j’étais curieuse. Porter deux styles vestimentaires totalement opposés allait-il changer ma perception de moi-même ? Allais-je me sentir moins butch, peut-être plus femme ?
D’un point de vue culturel, les vêtements et l’expression de genre peuvent revêtir des significations très différentes. Prenons l’exemple du kilt : une tenue qui, visuellement, s’apparente à une jupe, mais qui, portée par un homme écossais barbu et musclé, est perçue comme virile et imposante. Imaginez Braveheart, Mel Gibson déambulant fièrement dans un kilt dans la rue. Maintenant, imaginez-le dans une robe d’été de créateur. La perception change instantanément.
Avec Victor/Victoria en tête, j’ai trouvé pertinent de choisir, pour cette expérience vestimentaire, quelque chose de plus formel et typique d’une époque où les normes de genre étaient particulièrement rigides. Les robes victoriennes, historiquement luxueuses et élaborées, sont aussi incroyablement contraignantes, presque oppressantes avec leurs corsets serrés et leurs lacets ajustés. Une tenue qui transformait complètement mon apparence. À l’opposé de la robe victorienne se trouvait le smoking, un autre choix classique mais à l’allure beaucoup plus familière pour moi. Porter ces deux styles était loin d’être confortable, mais le smoking ressemblait davantage à ce que je pourrais porter aujourd’hui. La robe, en revanche, me donnait l’impression d’être déguisée. Parce que, soyons honnêtes, c’était un costume. À moins d’être invitée à une soirée Bridgerton en mode femme fatale, les robes de l’époque victorienne ne sont pas vraiment monnaie courante dans la vie de tous les jours.
Une fois habillée – ce qui a pris un certain temps –, j’ai eu l’impression de jouer un rôle, celui d’une Dame de la Maison, m’éventant avec grâce en essayant de me pavaner à travers les jardins (le mot-clé ici étant essayer). Ce qui est intéressant, c’est qu’à l’époque victorienne, les femmes n’avaient en réalité que peu de pouvoir. Pourtant, endosser un rôle aussi ultra-féminin donnait l’illusion d’une forme d’influence subtile, presque politique. Comme si j’incarnais Pénélope dans Bridgerton, manipulant en coulisses pour mieux tirer les ficelles du monde qui m’entourait. Ce pouvoir semblait plus intellectuel, tandis que le smoking, lui, me paraissait fade et banal. Certes, plus raffiné que mes costumes habituels, mais rien qui ne changeait ma manière d’être. Après des années à porter des vêtements masculins, j’étais déjà habituée à la confiance et à l’assurance qu’ils procurent. Je me suis alors demandé s’il existait une corrélation entre l’habit et l’attitude, entre les vêtements masculins traditionnels et une certaine prestance, voire une audace accrue. Imaginez si j’avais choisi une tenue de travailleur de la construction.
Une fois, pour Halloween, je me suis déguisée en Marie-Antoinette, avec une perruque d’un demi-mètre de haut, du maquillage et un crinoline cage qui me rendait l’entrée dans les portes absolument impossible. Tout comme avec la robe victorienne, j’ai ressenti une étrange sensation d’empowerment. Après tout, j’incarnais une reine, me pavanant comme un homme cisgenre blanc aux États-Unis, débordant d’un sentiment d’impunité et d’assurance.
Et puis il y a eu ce moment, des années auparavant, où j’ai dû être demoiselle d’honneur au mariage de ma sœur. J’étais habillée d’une robe en taffetas rose bonbon avec des talons roses de 7 centimètres ! J’ai descendu l’allée en priant pour ne pas me tordre la cheville, ressemblant à une boule de coton géante d’un mètre quatre-vingt. Je n’étais pas seulement limitée par le design même de la robe, mais aussi par ce que notre culture sous-entend tacitement comme un comportement féminin approprié en la portant : être modeste, discrète et docile.
Les vêtements influencent la façon dont nous nous sentons, à des degrés divers. Que ce soit pour une fête costumée ou dans la vie quotidienne, nous jouons tous des rôles, et notre expression de genre peut fluctuer, parfois de manière extrême. Se déguiser, c’est s’amuser, incarner quelqu’un que nous ne sommes pas. Tant que la société perçoit un costume comme un simple déguisement, il est socialement acceptable d’adopter une apparence ou un comportement différent. Mais si ce n’est pas un déguisement, cela devient soudainement un problème.
Notre culture, en particulier, a une vision rigide et étroite de ce qui est considéré comme une expression de genre acceptable pour certaines catégories de personnes. Imaginez un joueur de football américain ultra-macho portant un uniforme de pom-pom girl pour Halloween. Beaucoup trouveraient cela drôle. Mais s’il décidait de porter cette tenue dans sa vie quotidienne, il deviendrait immédiatement une cible, qualifié de tapette, de queer ou de garçon manqué. Tant que c’est un jeu, cela amuse. Mais si c’est une réalité, cela dérange.
Au fil des années, il y a eu des avancées : les vêtements que les gens portent, en particulier les femmes, se sont diversifiés, brisant progressivement les attentes sociétales. Dans ma jeunesse, en tant qu’athlète, j’ai observé une norme vestimentaire imposée aux femmes dans le sport. Le jour des matchs, mes entraîneuses – toutes d’anciennes sportives elles-mêmes, que je n’avais jamais vues autrement qu’en survêtement (imaginez Sue Sylvester dans GLEE, jouée par Jane Lynch) – arrivaient en jupe ou en robe. Elles entraient dans le gymnase, marchant d’un pas lourd, l’air forcé de porter ces tenues ultra-féminines. Et à chaque fois, elles ressemblaient simplement à… des athlètes à l’apparence masculine, en robe. C’était absurde et inconfortable à voir. Je riais souvent intérieurement en me demandant : « Qui vous oblige à porter ces robes mal ajustées, et pourquoi ? » Assises maladroitement sur le banc, jambes écartées, elles criaient leurs consignes, luttant contre l’incongruité de leur apparence.
Être butch n’est pas nécessairement synonyme de masculinité ou de ce que l’on appelle mascu. Une personne peut adopter une expression de genre masculine sans pour autant s’identifier comme butch. Tout est question de contexte.
Beaucoup de lesbiennes butch correspondent à la définition traditionnelle de cette identité : cheveux courts, vêtements masculins, et une sensation de bien-être à s’habiller ainsi, comme si leur apparence extérieure correspondait enfin à leur identité intérieure. Mais d’autres rejettent cette idée qu’une apparence masculine serait un prérequis pour être butch. Il est important de comprendre que ce terme ne se limite pas aux lesbiennes butch : il est aussi utilisé par des femmes trans, des hommes trans, des personnes non-binaires, queer, et même certaines femmes cisgenres.
Pensez aux drag queens. Certaines personnes perdent totalement pied en voyant une drag queen en talons hauts, maquillée, perruque et robe au vent, surtout si elle lit une histoire à des enfants dans une bibliothèque. D’un coup, cela devient un scandale, une question politique, presque une hérésie. Mais cette même personne, habillée en jean et t-shirt, traversera la rue sans susciter la moindre réaction. Enfin, sauf si elle sashay comme il se doit, auquel cas elle attirera sans doute quelques regards. Mais mis à part une gestuelle plus efféminée, c’est la même personne.
Être butch, ce n’est pas juste une question de vêtements. C’est une posture consciente, un mode de vie, une énergie confiante que je porte en moi. C’est un état d’esprit qui peut fluctuer selon mon humeur, un équilibre entre force et douceur. Mon identité de lesbienne butch ne se définit pas par une imitation des hommes ou de leurs comportements. Elle peut coexister avec des éléments féminins tout en restant profondément enracinée dans une expression que je ressens comme authentique.
Que mon confort se trouve majoritairement dans des vêtements masculins ou, de temps en temps, dans des pièces légèrement plus féminines, mon identité butch ne change pas. C’est quelque chose d’inné, une part de moi qui ne se limite ni aux apparences, ni aux conventions extérieures.
— Contribuez à notre magazine participatif —
Vous souhaitez écrire un ou plusieurs articles pour notre site ? Le Lesbia Magazine est un média libre et indépendant souhaitant porter toutes les voix de la diversité au féminin.
Envoyez-nous dès à présent votre sujet d'article via notre page de contact, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
Aujourd’hui, je me définis comme une lesbienne butch, mais ça ne veut pas dire que je me résume à des cheveux courts et à des chemises. Être une femme lesbienne masculine, pour moi, c’est avant tout un état d’esprit. Il m’arrive encore de porter des pièces plus féminines, mais ça ne change pas cette énergie masc que je ressens au fond de moi.
Je me reconnais aussi dans l’idée que la définition du mot butch dans le contexte LGBT n’est pas figée. J’ai rencontré des butches qui portent parfois des robes, et des lesbiennes mascu qui n’entreraient pas du tout dans l’image traditionnelle. Je crois que le plus important, c’est la cohérence entre ce qu’on ressent à l’intérieur et ce qu’on montre à l’extérieur.
Avec le temps, j’ai arrêté de me demander si je faisais assez butch ou pas. Je me sens libre de m’habiller comme je veux, de mixer les styles si ça me chante, sans avoir à justifier quoi que ce soit. Mon identité ne dépend pas d’un code vestimentaire figé. Et je crois que c’est là toute la force de notre communauté : il n’existe pas une seule façon d’être une butch lesbienne
- 22