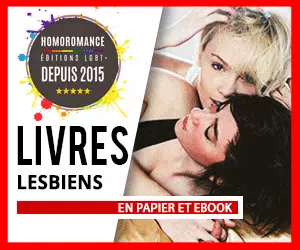Ma rupture avec la communauté lesbienne et gay

Je me rappelle du bon temps où je participais à toutes les Prides. La dernière c'était il y a.. quoi ? ... cinq ans à tout casser. J'aimais nos pancartes un peu bancales qu'on dessinait nous mêmes avant les dates des défilés. Je voyais encore ces célébrations comme un appel à l’unité, au respect, à la diversité, et je parle là du vrai sens du mot.
Des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, mais aussi des parents, des amis, des collègues, des hétéros solidaires. C'était une fête pour nos droits et aussi un moment de visibilité, un peu comme un nouvel an queer !
Et puis tout a basculé.
Je ne sais pas quand exactement... Je ne sais pas si ça s'est passé à un moment précis, si c'était une cassure nette ou plutôt un lent glissement vers quelque chose de plus insidieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'était pas quelque chose de clairement visible, plus une sensation qu’on ne voit pas venir, mais qu’on finit par ne plus pouvoir ignorer. Il y a eu un grain de sable en trop dans l'engrenage, celui qui a coincé la machine et la logique de ce combat.
Et c’est précisément là que je me suis écartée.
J’ai regardé de loin ce qui ressemblait à une “intersection des luttes” et l’idée sur le papier était sympa même si je ne m'y retrouvais pas : se rassembler, se soutenir, gagner en visibilité en unissant les combats. Pourquoi pas après tout.
Plus fort ensemble, n'est-ce pas?
Mais à force de tout vouloir inclure, l’intersection a fini par exclure.
Elle a justement sectionné. Elle a trié, écarté, hiérarchisé.
Et ceux qu’elle a mis en bas de l’échelle, ce sont souvent les mêmes qui étaient à l’origine des combats LGBT et portaient le mouvement. Pourquoi ? Parce que soudain, certaines voix devenaient trop “dominantes” pour être entendues. Trop blanches. Trop cis. Trop occidentales. Trop “privilégiées”, même quand elles ne l’étaient pas.
Le sigle lui-même a explosé en un rien de temps. D’un simple LGBT que certains questionnaient déjà, notamment le “T” qui renvoie à une identité de genre et non à une orientation sexuelle, on est passé à cette chimère absurde que plus personne ne comprend vraiment : 2SLGBTQIAA+ (?). Vous y comprenez quelque chose vous ?
Je me rappelle de cette actrice Lea DeLaria d’Orange Is the New Black qui l’avait surnommé “la soupe alphabétique”. Ça m’avait fait rire à l’époque. Aujourd’hui, je ne ris plus.
Mais ce n’est même pas ça, le vrai problème. Ce n’est pas la complexité du sigle. Ce n’est pas l’inclusion élargie. Le pire, c’est que les combats essentiels se sont noyés.
Petit à petit, des luttes satellites sont venues se greffer à une revendication initiale qui était pourtant claire, simple, universelle : avoir les mêmes droits que tout le monde. Ni plus, ni moins. Les droits fondamentaux. Ceux-là :
- Le droit d’aimer librement.
- Le droit de se marier.
- Le droit d’avoir des enfants.
- Le droit à la sécurité, dans l’espace public comme privé.
- Le droit de ne pas être discriminé à l’embauche, au logement, dans les soins.
- Le droit de vivre sans honte.
Mais ces droits, concrets, mesurables, évidents, collectifs, ont été relégués au second plan, noyés dans une accumulation de causes parfois légitimes, parfois opportunistes, de plus en plus politiques, aux services d'associations ou collectifs qui sont venus parasiter et asphyxier les luttes. Les luttes LGBT+ sont devenues un fourre-tout où l’on croise, pêle-mêle :
- l’antispécisme,
- la décroissance,
- l’écoféminisme,
- le véganisme,
- l’anticolonialisme,
- l’abolition du genre,
- la théorie queer appliquée à la biologie,
- la dénonciation de la méritocratie,
- le refus de l’universalisme,
- l’abolition du nucléaire,
- la cause palestinienne rendue obligatoire,
- le rejet des institutions publiques occidentales,
- la défense des minorités religieuses sans distinction,
- la cancel culture et l'appel à l'annulation généralisé
- la culture du trigger warning,
- la survalorisation du trauma,
- la primauté de l’auto-identification,
- le bannissement de l’humour,
- la disparition du débat contradictoire,
- la grille de lecture par oppressions cumulées,
- le rejet des personnes neurotypiques,
- la suspicion envers les corps et styles “conformes”,
- la valorisation de l’opacité identitaire,
- et, depuis peu, l’antisionisme militant devenu condition d’acceptabilité......
Et puis, plus tu cumules de critères d’oppression, plus ta parole a de valeur. Femme, racisée, autiste, vegan, neuroatypique, handicapée, trans, non-binaire, musulmane, migrante ?
Bravo : Tu gagnes le droit de parler.
Mieux : ... d’interdire aux autres de le faire.
Une femme cisgenre, juive, laïque ? Trop oppressante. Trop dominante. Qu’elle se taise.
Alors oui, je crois que c’est là que j’ai décroché... définitivement. Pas sur un coup de tête, non, c'est venu tranquillement, comme un cancer qu'on ne détecte qu'à la dernière minute quand c'est trop tard et qu'il n'y a plus de retour en arrière. Mais surtout c'est venue avec une forme de lassitude, de lucidité puis aussi d'usure. C'est ça... une usure d'écouter toutes ces personnes autoproclamées du camp du bien, de la bienpensance qui nous disent quoi combattre, qui annuler, comment réfléchir... et qui rendent nos combats absurdes et imposent leurs lois dans notre communauté au nom du "bien".
Je sais que je ne suis pas seule… On est beaucoup à regarder cette représentation théâtrale de loin, en silence, à ne plus dire ce qu’on pense de peur d’être étiqueté·e de classiste, essentialiste, colonialiste, raciste, sioniste, islamophobe, grossophobe, biphobe, validiste, antispécisteophobe, réactionnaire, féministe blanche, privilégiée, anti-woke, ciscentrée, transphobe, neurotypique oppressif·ve, carcéraliste, pro-flic, boomer, hétéronormé·e, universaliste (dans le mauvais sens du terme), traumaphobe, capacitiste, non-déconstruit·e, écofasciste, libéral·e, etc, etc, etc,... et plus simplement, jugé·e "inutile à la cause"...
Mais vous savez, ce n'est pas ça qui nous habite, ce n'est pas de la haine... je crois que c'est pire. C’est de l'indifférence, de la déception... et dans un couple ou encore dans une amitié sincère, quand on rompt, c'est qu'il n'y a plus d'issue possible, plus rien à réparer. C'est juste... fini.
La communauté queer que j’aimais, celle que je pense avoir aidée grandir à ma manière, était unie par l’envie de vivre mieux, ensemble. Elle n'avait pas besoin de désigner des ennemis à haïr. Elle appelait à l'amour, elle n’avait pas peur de la nuance, au contraire...
Elle ne sacralisait pas l’indignation, elle construisait ; elle ne censurait pas, elle ouvrait des portes aux débats et surtout, surtout, elle ne dressait pas des murs au sein même de son mouvement.
Aujourd’hui, j’ai l’impression que cette communauté s’est retournée contre elle-même...
Raison pour laquelle la rupture était le dernier recours : rompre comme on quitte quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un avec qui on n'est plus en phase et avec qui on n'a plus les mêmes valeurs... C'est un pas de côté pour suivre une autre voie, pour soi, pour respirer, penser, réfléchir, continuer à aimer les gens sans condition et puis surtout : pour conserver son esprit critique et rester libre sans haïr, sans suivre une idéologie qui est en train de tout détruire, même elle-même.
Et si tu te sens seul·e à penser ça, rassure-toi : tu ne l’es pas.
Je continuerai à raconter des histoires de femmes lesbiennes, à faire vivre des héroïnes fortes, tendres, ambiguës, dans des univers où leurs droits fondamentaux sont une évidence et pas un débat. Parce que c’est aussi ça, être lesbienne : créer des espaces où l’on respire, où on s'exprime librement.... sans censure.
— Contribuez à notre magazine participatif —
Vous souhaitez écrire un ou plusieurs articles pour notre site ? Le Lesbia Magazine est un média libre et indépendant souhaitant porter toutes les voix de la diversité au féminin.
Envoyez-nous dès à présent votre sujet d'article via notre page de contact, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
- 22
Et j'ai peu à peu décroché parce que les luttes se sont tellement éparpillées qu’elles en ont perdu leur sens premier : nos droits élémentaires. Aujourd’hui, la récup par LFI est clairement à vomir je me sens étrangère à un mouvement que j’ai pourtant contribué à porter. Je n’ai plus envie d’avoir à prouver ma légitimité d’exister selon une grille d’oppressions toujours plus compliquée et surtout injustifiée.