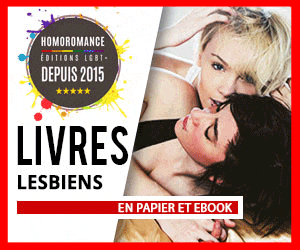Le féminisme récupéré : quand l’émancipation devient marché

J’écoutais aujourd’hui une émission intéressante où Léna Rey intervenait sur les liens entre capitalisme, wokisme et féminisme. Elle expliquait que le capitalisme, dans sa logique d’expansion, a besoin de créer sans cesse de nouveaux marchés, et que le wokisme s’y prête parfaitement. On ne parle plus seulement de consommateurs, mais de patients à vie, dépendants de traitements hormonaux, de chirurgies, d’un système médical devenu industrie identitaire. En parallèle, la société se fragmente : des individus isolés, des femmes seules, des foyers divisés. Et cette fragmentation n’est pas neutre : elle alimente la consommation. Double loyer, double assurance, deux voitures, deux vies à financer.
Le capitalisme et la création de marchés identitaires
Léna Rey avance que le capitalisme cherche constamment à créer de nouveaux marchés : nouveaux besoins, nouvelles dépendances, nouvelles identités à valoriser. Dans cette dynamique, « le wokisme » (le discours identitaire, de genre, etc.) y joue un rôle stratégique : il produit des groupes fragmentés, des individus qui deviennent « clients à vie », non pas seulement consommateurs, mais « patients » (par exemple dans une logique de traitements, chirurgies, interventions médicales liées à l’identité de genre).
Le résultat : on obtient une société ultra-fragmentée, où des « femmes seules », des individus isolés, des foyers disloqués, deviennent de facto un terrain de marché. Une fragmentation qui assure une double consommation (double loyer, double assurance, deux véhicules, etc.) est un moteur du capitalisme.
Ainsi, selon cette analyse, le problème n’est pas seulement la consommation, mais la manière dont le capitalisme fabrique la fragmentation sociale pour stimuler la consommation.
Ce que Lena Rey identifie aussi c'est la façon dont les grandes causes (égalité, genre, etc.) sont devenues des vecteurs de marché, et non seulement des causes de justice.
Le rôle des fondations et du philanthro-capitalisme
Un autre volet central de son argumentaire est le rôle joué par les grandes fondations privées, comme la Ford Foundation ou la fondation de George Soros, dans la diffusion et le financement de ces nouveaux discours. Ces structures, qui ne sont pas élues, exercent une influence considérable, en finançant des causes, des ONG, des think-tanks, des médias, voire des mouvements. En injectant de l’argent, elles définissent aussi des agendas, orientent des récits, fragmentent les sociétés selon des logiques identitaires.
Léna Rey suggère que sans ce soutien financier massif, les dynamiques « woke » resteraient anecdotiques. Mais grâce à ces fonds, elles deviennent structurelles, intégrées, et par conséquent profondément influentes. On passe donc de la politique démocratique classique à une politique par l’argent privé, ce qui pose la question de la légitimité : qui décide réellement ?
Elle note par ailleurs l’ironie : ce sont souvent « des hommes blancs hétéros » qui financent ces mouvements dont ils sont ostensiblement les « ennemis ». On ne critique pas la « main qui nourrit ». Ce biais renforce, selon elle, une forme de récupération.
Le féminisme récupéré : de l’émancipation à la marchandisation
Dans son association des idées, Léna Rey articule que l’émancipation de la femme a été vendue comme une conquête, mais qu’en pratique elle s’est transformée en dispositif de marchandisation. Exemple : les plates-formes comme OnlyFans, les droits à disposer de son corps revendiqués (ce qui est juste en soi), mais dans un cadre où ces corps deviennent marché, exploités, valorisés, consommés.
Elle soutient que ce sont surtout les hommes (clients, exploitants, capitalistes) qui gagnent à cette marchandisation. Les femmes, prétendument « empowered », deviennent en réalité des actrices dans un marché inconscient où ce sont d’autres qui s’enrichissent.
Le féminisme, ainsi récupéré, perd une partie de son contenu critique : il ne questionne plus seulement le patriarcat, il intègre la logique du profit. L’égalité devient, dans certains cas, une prestation à vendre, l’autonomie corporelle devient marchandise.
Par cette transformation, on peut craindre que l’« émancipation » se fasse au détriment de la solidarité collective, de la lutte contre les structures, et se réduise à des formes individuelles, consuméristes.
Mon avis
Ce que Léna Rey met en lumière est incontestablement pertinent : la logique marchande pénètre effectivement les mouvements sociaux, l’émancipation peut être détournée, et les dynamiques de fragmentation sociale ne sont pas neutres.
Mais certaines réserves peuvent être émises :
- Le féminisme comporte une grande diversité : toutes les actions féministes ne sont pas récupérées par le capitalisme, et beaucoup conservent un esprit critique radical.
- Il faut distinguer les effets structurels (exploitation, marchandisation) des intentions individuelles (beaucoup de femmes agissent avec authenticité).
- La marchandisation du corps n’est pas exclusive aux femmes modernes ou aux plateformes numériques : l’histoire a connu d’autres formes de commercialisation, et le lien entre autonomie corporelle et exploitation mérite une nuance.
- Enfin, si on admet que les fondations privées ont un rôle, il faut aussi interroger la responsabilité des États, des régulations, des médias, la dynamique ne vient pas uniquement «d’en haut».
En bref : l’alerte de Léna Rey est une invitation à reconquérir un féminisme collectif, critique, non marchand. Elle appelle à la vigilance face à la captation du mouvement par des logiques économiques.
Pistes de réflexion et appel à vigilance
Le féminisme ne peut être réduit à une marque, à un service ou à un marché. Il ne peut pas non plus être instrumentalisé par des acteurs privés sans perdre de son pouvoir critique. En effet, quand l’émancipation produit de la consommation plutôt que de la transformation sociale, on s’éloigne de l’objectif originel.
Léna Rey nous rappelle que :
- la fragmentation de la société (foyers éclatés, individus isolés, dépendances) profite à un capitalisme insatiable.
- la philanthropie privée a un pouvoir immense pour façonner les récits, mais ce pouvoir appelle à une transparence démocratique.
- le féminisme doit être réapproprié, non comme simple « marque », mais comme lutte contre les dominations multiples, économiques, sexuelles, de genre, raciales.
Pour toutes celles et ceux qui se disent féministes, l’enjeu est clair : ne pas laisser le mouvement devenir un marché, mais le reconduire comme une transformation collective, un pouvoir d’agir ensemble, pas simplement un individu consommateur libre.
Et vous, comment voyez-vous ce péril de la « marchandisation de l’émancipation » ? Êtes-vous d’accord avec cette lecture ? Peut-être qu’il existe d’autres leviers que ceux évoqués ici…
— Contribuez à notre magazine participatif —
Vous souhaitez écrire un ou plusieurs articles pour notre site ? Le Lesbia Magazine est un média libre et indépendant souhaitant porter toutes les voix de la diversité au féminin.
Envoyez-nous dès à présent votre sujet d'article via notre page de contact, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.