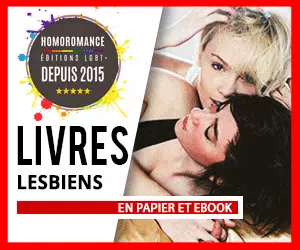La série queer de Mae Martin sur Netflix va vous retourner le cerveau

(Attention : cette critique contient quelques révélations sur l’intrigue.)
Wayward, la nouvelle série d’horreur queer en huit épisodes créée par Mae Martin, s’ouvre sur une fuite nocturne. Un jeune garçon se hisse par la fenêtre d’un bâtiment avant de courir à perdre haleine jusqu’à la limite de la propriété. Une voix féminine résonne dans la nuit, scandant un vers qui deviendra bientôt aussi glaçant pour le spectateur que pour les adolescents au cœur de l’histoire. L’enfant franchit une clôture barbelée, puis s’abandonne dans un lac marécageux pour échapper à ses geôliers. Et dans ce lac ? Une porte. Une image qui hantera ensuite toute la série. Car à Tall Pines, petite ville du Vermont où se déroule Wayward, il est impossible de fuir les dommages que les adultes infligent aux adolescents, sous prétexte de réparer ceux que d’autres adultes ont causés avant eux.
Nous sommes en 2003. Ce garçon mourra bientôt. Dans cette ville puisqu'en sortir vivant relève de l’impossible. Tall Pines vit au rythme de son « école » pour jeunes en difficulté, qui fonctionne en réalité comme une prison. De l’autre côté de la frontière, à Toronto, nous rencontrons Abbie (Sydney Topliffe) et Leila (Alyvia Alyn Lind), deux meilleures amies inséparables qui préfèrent la musique, l’ivresse et leur amitié aux bancs de l’école. Des adolescentes ordinaires, en somme : cabossées, certes - Leila porte le fantôme d’une sœur disparue, Abbie refuse de se plier aux attentes d’une famille riche qui la méprise - mais rien de plus que des adolescentes en rébellion, prêtes à se pousser l’une l’autre vers leurs excès comme le font souvent les amitiés fusionnelles de cet âge. Pourtant, les adultes les perçoivent comme irrémédiablement brisées, presque dangereuses. Abbie est alors envoyée de force à Tall Pines, et Leila, dans un élan d’amour et d’inconscience, se lance à sa rescousse… pour se retrouver elle aussi piégée dans le système. Là, des jeunes de tous horizons doivent gravir des « niveaux » de discipline et de soumission, soumis à des thérapies douteuses que même les adolescents reconnaissent comme de la pseudo-science.
Tout cela ressemble à une secte ? C’en est une.
Et à sa tête se tient Evelyn, personnage sorti tout droit des années 1970 mais parachuté en 2003. Toni Collette lui prête ses traits, un choix de casting brillant : capable d’incarner la cruauté avec une humanité glaçante, elle donne à Evelyn une crédibilité effrayante. On ne l’excuse jamais, mais son obsession du contrôle sonne vrai, comme un écho des discours d’adultes persuadés que les jeunes doivent être façonnés, domptés, transformés en petits soldats dociles. Son mal est d’autant plus terrifiant qu’il est humain, nourri par une soif de pouvoir et une haine viscérale de toute expression de liberté. Une figure digne des Moms for Liberty.
(Si je ne croise pas d’Evelyns à Halloween cette année, je serai franchement déçue.)
Alors que la plupart des adolescents cherchent désespérément à fuir Tall Pines, deux adultes - Alex (Mae Martin) et Laura (Sarah Gadon), un couple marié - viennent s’y installer. Laura, enceinte, est une ancienne élève de l’institution, mais elle a toujours tenu son mari à l’écart de ce passé. Alex, policier et trans, découvre ce monde inquiétant. La série n’encense en rien la police : les flics locaux ne sont qu’un rouage de plus dans cette machine de violence institutionnalisée. Pourtant, le fait qu’Alex soit policier semble surtout répondre à une commodité scénaristique ; son rôle d’« enquêteur extérieur » aurait pu trouver d’autres justifications.
Fait remarquable pour une petite ville en 2003 : la transidentité d’Alex n’est jamais remise en cause. Ses injections de testostérone ou son quotidien sont évoqués avec une simplicité déconcertante. Wayward donne la part belle aux personnages queer : Leila est bisexuelle, Rabbit - le bras droit d’Evelyn - l’est aussi. La série ne traite pas l’homosexualité ou la transidentité comme des problèmes à « corriger ». Tall Pines ne « prie pas pour chasser le démon gay » : elle drogue et brise les âmes. Le propos de la série ne se limite donc pas à la queerphobie, mais élargit son regard sur l’obsession du contrôle des jeunes en général. Et rappelle, avec force, que les attaques contre les ados queer et trans portent atteinte à tous les ados, en les privant de liberté et d’expression.
La série atteint son apogée horrifique entre les épisodes 6 et 8, lorsque Evelyn oblige Leila à revivre le jour de la mort de sa sœur, brouillant les frontières du temps et de la mémoire. À la manière de Yellowjackets, Wayward parsème son récit de signes surnaturels : portes étranges, trous de mémoire, crapauds qui coassent comme des avertissements. Pourtant, le surnaturel n’est qu’une illusion : la véritable horreur réside dans la réalité des traumatismes et des violences institutionnelles. Les pensionnats de redressement, encore nombreux aux États-Unis, existent bel et bien, souvent en ciblant les jeunes queer et trans. Wayward ne relève pas de la science-fiction : il met en scène une horreur bien réelle, terriblement contemporaine malgré son cadre de 2003, en résonance avec les tentatives actuelles d’endoctrinement et de punition des jeunes comme instrument du fascisme.
À Tall Pines, la logique de la secte prétend briser les traumatismes intergénérationnels… tout en reproduisant les mêmes méthodes d’autorité, de règles et de châtiments. Sydney Topliffe et Alyvia Alyn Lind livrent des prestations magistrales dans le rôle d’Abbie et Leila, dessinant des adolescentes entières, vibrantes, là où les adultes cherchent à les réduire. Sarah Gadon, elle, joue Laura avec une subtilité inquiétante : son comportement devient peu à peu plus dérangeant, pour Alex comme pour le spectateur.
Wayward livre juste assez de réponses sur les racines de Tall Pines et son passé pour bâtir son mystère sans s’enliser dans une mythologie inutile. Le plus effrayant reste la banalité de ce système : les tentatives de contrôler la jeunesse sont inscrites dans l’histoire carcérale du pays. La série ne fait qu’en accentuer l’aspect cauchemardesque. Même quand l’écriture manque parfois de rigueur, le résultat glace le sang.
La bande annonce de Wayward
— Contribuez à notre magazine participatif —
Vous souhaitez écrire un ou plusieurs articles pour notre site ? Le Lesbia Magazine est un média libre et indépendant souhaitant porter toutes les voix de la diversité au féminin.
Envoyez-nous dès à présent votre sujet d'article via notre page de contact, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.